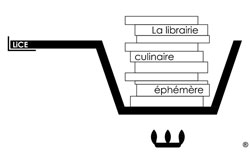© Philippe Matsas/Plein Jour
Jean –Marc Quaranta
Houellebecq aux fourneaux, Plein Jour, avril 2016
Bonjour Jean-Marc Quaranta, eau plate ou eau gazeuse ?
Eau gazeuse. Mais, bien que profondément laïc, je préfère quand elle se change en vin !
Quel plat mangez-vous bien volontiers en ce moment ?
En général le plat que j’aime manger est celui que j’aime cuisiner et partager ! En ce moment c’est le poulet aux piments verts de Plateforme, que j’ai cuisiné au Salon du livre et que je vais préparer pour les quatre-vingts ans de ma mère, à qui le livre est dédié. Dans le roman de Houellebecq, c’est un plat que le narrateur mange au moment où il s’apprête à mener une vie paradisiaque avec sa compagne et où elle envisage qu’il s’adonne à sa passion pour la cuisine. Il pense accommoder le plat « avec des mangues », mais hélas la suite de l’histoire ne lui en laissera pas le temps. Un bon exemple de l’importance de la cuisine chez Houellebecq puisque l’auteur en fait un des éléments du bonheur, qu’il croit impossible, et la place à des moments clés de son roman.
Avez-vous toujours mangé ce plat ?
Non, je l’ai découvert en travaillant sur le livre, puisque le projet consistait à commenter les romans de Houellebecq du point de vue de la nourriture et de la cuisine, en faisant les recettes, ce qui m’a permis de faire quelques belles découvertes et de préciser parfois le sens caché du texte, qui est parfois opposé au sens apparent, et que la cuisine révèle ! Avec 75 recettes – sur les 200 plats que comportent les six romans – j’ai aussi enrichi mon répertoire culinaire dans cette aventure, même si de nombreux plats appartenaient déjà à mon propre livret de recettes.
Quel est votre parcours culinaire ?
J’ai commencé, enfant, dans la cuisine familiale avec ma mère et ma sœur, qui a fait l’école hôtelière et a donc apporté à la fois sa passion et ses techniques (que je suis loin d’égaler). Après, à l’adolescence, ma mère a exercé une activité de traiteur et j’allais la regarder faire, je l’aidais aussi un peu, mais pas beaucoup, la cuisine était son refuge, son monde, y entrer aurait été une maladresse. Ensuite j’ai travaillé à Monaco, pendant mes études, dans un hôtel de luxe, en salle, mais j’allais souvent faire un tour en cuisine. C’était la même chose dans les restaurants plus petits où j’ai pu travailler comme serveur à la même époque. Ma pratique de la cuisine est essentiellement personnelle et familiale, je cuisine pour moi et pour la famille, pour les amis.
A-t-il plutôt influencé votre façon de manger, ou ce que vous mangez ? En quoi?
Il a déterminé un choix, assez rare hélas aujourd’hui, de ne pas recourir à la cuisine industrielle. Le seul plat que je m’autorise dans ce domaine est la paëlla ! C’est même devenu un rite et une plaisanterie dans la famille. Je cuisine donc tous les jours, ou presque, parfois en grandes quantités pour que cela puisse durer quelques jours. Cela m’a aussi conduit au marché, pour avoir des produits frais et de la matière première. A l’heure du développement de la culture vegan, je comprends bien la nécessité de porter une attention sérieuse à la condition de l’animal, mais je crois plus urgent de reprendre en mains notre nourriture en limitant le recours à la nourriture industrielle. Ce n’est pas seulement un enjeu sanitaire, c’est aussi tout un rapport au monde qui se joue dans ce qu’on sent, ce qu’on touche, ce qu’on réalise, dans l’autonomie qu’on acquiert par cette activité qui, en définitive, nous tient en vie. C’est le sens de Houellebecq aux fourneaux : Houellebecq décrit une évolution de la société qui conduit à la destruction des anciennes structures, il est clair qu’elles ne reviendront plus – et ce n’est pas un mal – mais il faut bâtir un art de vivre qui nous rende plus présents au monde. Les personnages de Houellebecq se plaignent de ne rien savoir faire de concret, de gérer seulement des flux d’informations et cette impuissance devant le monde réel, devant la matérialité du monde, les angoisse ; la cuisine aide à se libérer de cette angoisse en nous redonnant la main – celle qu’on met à la pâte – sur le monde et sur nos vies.
Pouvez-vous nous raconter une première fois culinaire (préparation ou dégustation) ?
Quand on déguste un plat, même si on l’a déjà fait, c’est toujours la première fois, puisque chaque réalisation est différente. Dernièrement j’ai fait une confiture d’oranges, avec les fruits qu’un ami m’a apportés de son jardin, je l’a goûtée après quelques heures de repos, dans un contexte de tensions sur le plan professionnel, et ça a été un moment d’apaisement qui remettait les choses essentielles à leur place, et reléguait les autres au second plan. Le matin, quand je prends une cuillère de cette confiture, que je trouve excellente, je repense que l’essentiel est que la confiture d’oranges soit réussie, le reste importe peu !
Quel est selon vous l’aliment qui incarne le mieux la mobilité de l’humain de nos jours?
Dans La Carte et le territoire, c’est le coleslaw qui incarne le mieux cette mobilité : un plat qui a lui-même beaucoup voyagé et qu’on peut retrouver partout. La pizza est certainement le plat le plus mondialisé : j’ai vu à Alger une échoppe qui vendait des « pizzas australiennes ». Difficile d’exprimer mieux la mobilité des plats et l’appropriation dont ils sont l’objet dès qu’ils voyagent. La cuisine a toujours incarné cette mobilité car elle marque les différences mais parce qu’aussi les ressemblances sont importantes, sous l’apparente diversité. J’en donne des exemples étonnants dans Houellebecq aux fourneaux notamment à propos de Soumission qui a fait beaucoup de bruit et qu’on a mal lu.
Le plat de la mobilité de l’humain, pour moi, ce serait sans doute le couscous car il fait l’objet d’un va et vient entre les deux rives de la Méditerranée ; c’est un plat important dans Les Particules élémentaires. Au départ c’est un pot-au-feu, qui devient un plat épicé en traversant la mer et qui revient en France comme le plat préféré des Français, alors même que pour une partie de la population la relation avec le Maghreb et, plus généralement l’islam, pose problème et questionne sa propre identité. Et puis, il y a ce paradoxe qu’il n’y a pas un couscous mais une grande diversité, presque un par famille. Le couscous réalise dans les assiettes le rêve d’une mondialisation heureuse et le rapport entre intime et collectif. En Angleterre, c’est le poulet korma (dont la recette se trouve aussi dans le livre) qui joue ce rôle de lien entre la métropole et les anciennes colonies devenues territoires de migrations. Il est beau que cette chose simple, banale, quotidienne qu’est la cuisine puisse le porter.
Quel aliment vous ferait défaut aujourd’hui si vous deviez vous en passer pendant un an ?
Difficile à dire, peut-être le fromage, ou le poisson. Sans doute tout me manquerais, mais je pense que je pourrai assez vite m’y habituer, quel que soit l’aliment.
Si on se fiait à vous pour nous recommander un restaurant ?
Comme je cuisine, je mange beaucoup à la maison et je suis souvent déçu au restaurant, sauf à aller chez des chefs étoilés – ce que pour le moment les ventes de mon livre ne me permettent pas ! Nous avons organisé un repas houellebecquien à la Bellevilloise dans le cadre de Paris en toutes lettres, avec la Maison de la poésie et c’était très bien. Le chef et son équipe avaient choisis des plats tirés du livre et leur choix était très pertinent et le travail très appliqué. Pendant le repas je mangeais et commentais les plats. Noam Morgenzstern, de la Comédie française, lisait des extraits, c’était bon, beau et intéressant ! Une expérience à renouveler, avec ceux qui le souhaitent.
Sinon, hors de France, j’ai le souvenir d’un repas à Cracovie, chez Wierzynek, le restaurant existe, au même emplacement, depuis le moyen âge et j’ai eu l’impression que les plats mijotaient depuis des siècles, que le temps les avait distillés et décantés, qu’il y avait une perfection, un équilibre parfait qui étaient atteints, et cela avec une grande simplicité, avec naturel. Le temps était présent et sensible dans la cuisine qu’on mangeait. Si on me proposait de reprendre l’avion pour aller y manger, je le ferais !
Si vous deviez nous présenter un produit et en partager la recette avec nous ?
Le poulet aux piments verts dont voici la recette
Dans le caddie : 3 à 4 tiges de citronnelle, 3 à 4 oignons frais (thaï de préférence), le zeste d’un citron vert, 3 gousses d’ail, de 1 à 5 piments verts (selon vos goûts), 60g de gingembre, nuoc-mam, 1 botte de coriandre fraîche, coriandre en poudre, cumin, curcuma, 500 cl de lait de coco ; 500g de blancs de poulet, 2 poivrons, 2 petites aubergines, basilic thaï.
Préparation de la recette : le curry vert : peler si besoin la citronnelle et la couper en rondelles, peler et couper grossièrement l’ail, les piments, le gingembre, la moitié de la botte de coriandre (tiges comprises) ; délayer avec une peu de lait de coco ; 1cas de coriandre, 1 cas cumin, 1 cas de curcuma.
Faire bouillir 500cl de lait de coco pendant 10 min, ajouter 2cas de curry vert et cuire encore 2 minutes ; épluchez les aubergines et les couper en dés de 2cm environ ; plonger les aubergines dans le lait de coco, avec du nuoc-mam et 4 cas de curry vert, faire bouillir à feu doux pendant 10 min ; couper les poivrons en lamelles et le poulet en dés ; ajouter le poulet les poivrons et faire cuire 5 à 10 minutes à feu doux jusqu’à ce que le poulet soit cuit. Sortir du feu et ajouter la coriandre et le basilic hachés grossièrement.
Servir avec du riz.
Extension : Le curry se conserve une bonne semaine au réfrigérateur.
Pour finir, quelques mots sur l’altérité et le « vivre ensemble »
J’en ai parlé à propos de la mobilité, la cuisine porte les marques du vivre ensemble, elle est par définition assimilation – la fait de cuisiner sert aussi à faciliter la digestion, l’assimilation des aliments, par la découpe et la cuisson – et cette assimilation se produit aussi sur le plan des individus et des cultures. Ce qui parfois semble mal se passer dans les relations à l’autre, en surface, se passe bien en réalité dans l’assiette, c’est ce qu’on remarque chez Houellebecq. La meilleure illustration est le repas de famille : on s’y dispute souvent (pas chez Houellebecq, où ils sont des moments paradisiaques), mais on peut le faire car on partage le même repas. Même si les interdits religieux, les problèmes de santé ou les choix alimentaires peuvent limiter les échanges et les rencontres culinaires, en règle générale, vivre ensemble c’est manger ensemble et de ce point de vue toute le monde ou presque se retrouve dans la cuisine et autour de la table, c’est le lieu où il peut être facile de vivre ensemble avec ses différences. La plus jeune de mes filles est devenue vegan par souci de la condition animale, cela n’empêche pas le partage, même si ça semble compliquer les menus. La cuisine apprend la tolérance et la nécessité de partager, de faire corps. Dans les moments difficiles et inquiétants que nous traversons, c’est un espoir.